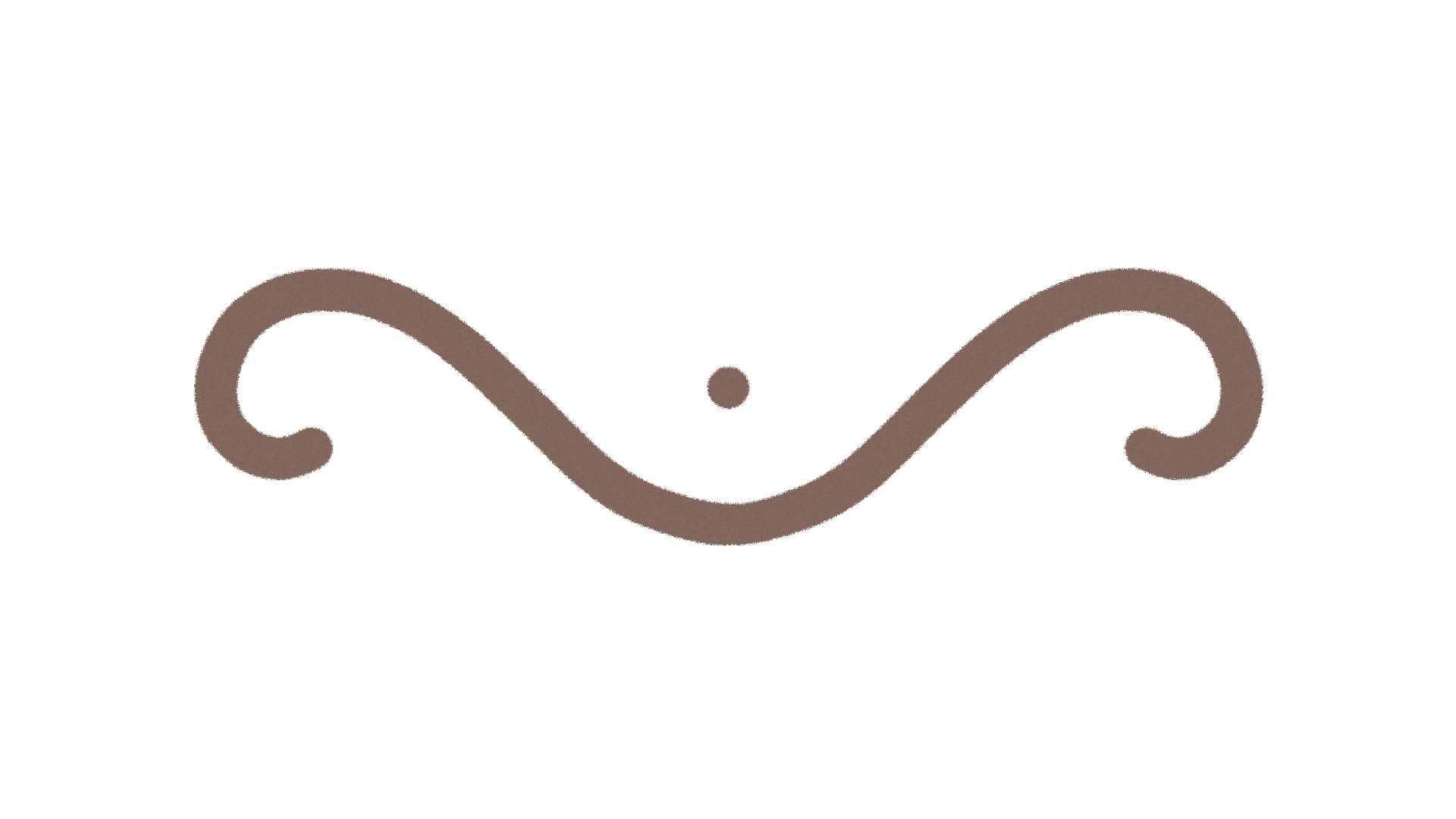Cet article est issu de mon travail de projet réalisé dans le cadre de l’obtention du diplôme d’enseignante de yoga de l’association professionnelle Yoga Suisse. Ce travail explore la question suivante : « De quelle manière le yoga, à travers ses différents systèmes, anciens et modernes, se propose-t-il comme un moyen d’union au divin ? ». La version complète est disponible ici.
La civilisation de la vallée de l’Indus est l’une des premières grandes civilisations de l’Histoire, prenant forme vers 3300 av. J.-C dans la région actuelle du Pakistan et de l’Inde occidentale. Autour du 17e siècle avant notre ère, des peuples aryens (du sanskrit ārya, « noble », désignant un groupe ethnolinguistique indo-européen) ont migré dans l’Inde ancienne1. Les Aryens y ont introduit la langue sanskrite et importé leur système de caste. C’est le début de la période védique, qui doit son nom au Veda (le « Savoir »), le premier texte sacré2 qui formera alors le socle philosophique et spirituel de la culture indienne. Le terme yoga y apparait pour la première fois, signifiant « l’attelage » (des chevaux au char de guerre). La racine sanskrite verbale yuj, signifiant « atteler », « joindre » ou encore « unir », évoque déjà une composante essentielle de cette discipline en devenir…
La religion védique était fortement ritualiste et réservée à la caste des brahman, les prêtres. Mais au fil des siècles, des brahman progressistes et des ascètes renonçants spéculent sur la métaphysique et réinterprètent les enseignements védiques, ce qui mène à la diversification de la pensée indienne et la naissance de nombreux courants philosophiques et spirituels, et avec eux, d’un vaste corpus littéraire3. Parmi eux, on mentionnera les Upaniṣad ou Vedanta (fin du Veda), dont les douze « anciennes » furent principalement composées pendant la période préclassique (de 600 à 300 av. J.-C.). Ces textes intériorisent fortement la pratique spirituelle en explorant des questions fondamentales sur la nature humaine et la quête individuelle de libération. Le rapport à soi-même et au divin y est défini à travers les concepts d’Ātman (le Soi, l’âme individuelle) et de Brahman (l’Absolu, l’âme universelle, la réalité ultime). Les Upaniṣad suggèrent que la véritable libération4 (mokṣa) est atteinte par la connaissance et la réalisation de l’unité essentielle entre Ātman et Brahman. Dans la Katha Upaniṣad, qui raconte le dialogue entre un jeune brahman nommé Nachiketas et Yama, le dieu de la mort, celui-ci lui enseigne :
« Sache-le, l’Atman est le passager, le corps est le chariot, l’intellect (buddhi) est le cocher, et le mental (manas) est les rênes.
Les sens sont, dit-on, les chevaux, les objets visibles sont leurs pistes. L’Atman, qui est couplé au corps, aux sens et au mental, est appelé par le sage « le jouisseur ». »
Katha Upaniṣad, chapitre 1 liane 3 strophes 3 et 4, traduites par Martine Buttex (2012)
« C’est seulement lorsque le mental, couplé aux cinq sens, est parvenu à s’immobiliser et lorsque l’intellect ne vacille plus, que le but suprême, comme on l’appelle, est atteint. Cette emprise ferme et continue sur les sens, voilà ce qu’on appelle yoga. Ce faisant, on doit éviter toute léthargie, car le yoga est création et destruction, tout à la fois. »
Katha Upaniṣad, chapitre 2 liane 3 strophes 10 et 11, traduites par Martine Buttex (2012)
Nous retrouvons dans cette Upaniṣad une première mention explicite du yoga en tant que moyen d’union de l’homme (Ātman) au divin (Brahman), ce par le contrôle de l’esprit.
La période préclassique, extrêmement féconde5, nous offre également la Bhagavad Gītā. Texte fondamental de l’hindouisme et du yoga, sixième livre du Mahābhārata6, ce poème épique est rédigé autour du cinquième siècle avant notre ère. Il raconte en 700 strophes (śloka) le dialogue entre le guerrier Arjuna et Krishna (Kṛṣṇa) sur le champ de bataille. Krishna y délivre son triple-enseignement : la voie de l’action juste (karma yoga), la voie de la connaissance (jñāna yoga) et la voie de la dévotion (bhakti yoga). Ici se dessinent les trois premières et principales voies (mārga) du yoga.
Pendant la période classique (de -300 à 300 ap. J.-C.), alors que les Upaniṣad continuent de se développer et que la transmission et les commentaires de la Bhagavad Gītā fleurissent, viennent se cristalliser les darśana (« points de vue »), les six écoles philosophiques orthodoxes de l’hindouisme. Basées elles aussi sur les Veda, chacune explore différentes dimensions de la connaissance et de la réalité. Elle se nomment Nyāya, Vaiśeṣika, Mīmāṃsā, Vedānta, Sāṃkhya et… Yoga ! Ici, on parle du yoga classique ou royal (rāja yoga). Le légendaire Patañjali compile les savoirs accumulés jusqu’à présent et pose les fondements de cette quatrième et majeure voie (mārga) du yoga dans les Yoga Sūtra. Écrit en sanskrit entre -200 et 200 ap. J.-C., ce traité est composé de 196 aphorismes (sutra) et présente les huit membres (aṣṭāṅga) qui composent la méthode du yoga7.
Le yoga continue de se développer pendant la période post-classique (de 300 à 1500 ap. J.-C.). Une influence majeure est celle du tantrisme, un courant de pensée d’origine indo-himalayenne apparaissant autour du sixième siècle de notre ère et ayant imprégné la plupart des philosophies indiennes (hindouisme, bouddhisme, jaïnisme). Le tantrisme conçoit que l’univers repose sur deux polarités : le principe féminin (symbolisé par Śakti) et le principe masculin (Śiva). Il développera notamment l’approche énergétique du corps (kuṇḍalini, nādi et cakra). Les doctrines (tantra) enseignent diverses méthodes initiatiques, rituels et pratiques, qui coloreront les méthodes du yoga, notamment celles du haṭha yoga, qui se développera fortement entre le 11e et 18e siècle et que l’on peut considérer comme un développement du rāja yoga.
À partir du 19e siècle, l’expansion mondiale du yoga est rendue possible grâce à des figures tels que Vivekananda, Sri Aurobindo, Yogendra, Kuvalayananda, Sivananda, Krishnamacharya et Yogananda. La modernisation et la mondialisation du yoga racontent à leur tour une histoire complexe ; pour l’instant, notons simplement que le yoga moderne est le fruit d’un riche métissage entre Inde et Occident.
Ainsi, les origines du yoga sont indissociables de l’hindouisme. L’histoire du yoga n’a absolument rien de linéaire, contrairement à ce que ce résumé pourrait laisser croire. Ce que l’on appelle yoga englobe en réalité une variété de courants métaphysico-spirituels et de pratiques ascétiques qui se sont développés simultanément et avec l’influence des systèmes philosophiques et traditions religieuses qui leurs furent contemporains, tels que le Vedānta, le shivaïsme, le vishnouisme, le tantrisme, le jaïnisme, le bouddhisme, mais aussi l’islam pendant l’empire moghol. La rencontre du yoga avec la culture occidentale, bien qu’elle ait permis son expansion mondiale, a profondément transformé sa pratique ; nous discuterons de ces implications dans le prochain article.
Il n’existe alors pas de yoga originel. Ce sont des siècles d’introspection, d’expérimentation et de contemplation qui ont mené à l’évolution de cette discipline des corps, depuis la période védique8 jusqu’à aujourd’hui. En tirer des larges catégories est bien évidement utile à la compréhension, mais il ne faut pas oublier la richesse des centaines d’écoles, de lignées et de guru qui ont chacune transmis la sagesse du yoga d’une façon unique, offrant milles et une interprétations de son expérience.
Nous avons mentionné les quatre grandes voies (mārga) du yoga : karma yoga, bhakti yoga, jñāna yoga et rāja yoga. Voyons à présent ce que chacune d’entre elles propose comme méthode et en quoi elles constituent des moyens d’union au divin.
- Aujourd’hui, la théorie d’une migration progressive des Aryens vers l’Inde ancienne par rapport à celle d’une invasion violente est privilégiée. ↩︎
- Le terme sanskrit śruti signifie « ce qui a été entendu » et désigne l’ensemble des textes révélés aux ṛṣi, les anciens sages : les quatre recueils du Veda, les Brāhmaṇa, les Āraṇyaka et les 108 Upaniṣad. Il s’oppose au terme smṛti, « mémoire », qui désigne la littérature traditionnelle basée sur les enseignements de la śruti : les sciences, les aphorismes, les épopées et légendes comme le Mahābhārata et le Rāmāyaṇa et les six darśana dont le Yoga. ↩︎
- Il faut noter que la tradition indienne était principalement orale, mettant l’accent sur la relation maître-disciple comme fondement de la transmission des enseignements philosophiques et spirituels. Les écrits, dans ce contexte, servaient surtout de supports pour la préservation et la diffusion de cette connaissance. Ainsi, les textes qui nous sont parvenus aujourd’hui, dont les datations sont largement imprécises, ne reflètent qu’une image fragmentaire de la richesse de cette tradition. ↩︎
- Moksha se réfère à la délivrance du cycle des réincarnations (saṃsāra), autrement dit, la libération de la souffrance due à l’impermanence des choses. ↩︎
- C’est également à ce moment que naissent les traditions bouddhistes et jaïnistes, considérées comme des philosophies indiennes nāstika, « non-orthodoxes », c’est-à-dire ne reconnaissant pas l’autorité du Veda. Cette période fascinante de l’histoire voit en fait vivre en contemporains les maîtres des Upaniṣad, Siddhārta Gautama (le Bouddha), Mahāvīra (le fondateur du jaïnisme), Confucius et Lǎozǐ en Chine, Thalès de Milet, Pythagore, Héraclite, Socrate, Platon, Aristote dans la Grèce Antique, … et avec eux, une effervescence intellectuelle et spirituelle. ↩︎
- Le Mahābhārata et le Rāmāyaṇa sont deux récits traditionnels ayant joué un rôle crucial dans le développement des courants dévotionnels en Inde (ici le vishnouisme, le cocher Kṛṣṇa et le roi Rāma étant tout deux des avatāra du dieu Viṣṇu). ↩︎
- Il est intéressant de noter que Yoga darśana est considéré comme le versant « pratique » du Sāṃkhya darśana. Le Sāṃkhya est une théorie métaphysique qui explique l’univers à travers l’interaction de deux réalités fondamentales, Purusha (la conscience) et Prakriti (la matière, la création). ↩︎
- Certaines recherches archéologiques suggèrent même qu’il existait un yoga pré-védique au sein de la civilisation de l’Indus. Ce proto-yoga chamanique et indigène aurait influencé le développement du yoga dans la période védique et les suivantes… ↩︎
Bibliographie
Buttex, M. (2012). 108 Upanishads. Dervy.
Image : Auteur inconnu. (18e siècle). A Yogini and her Young Disciple [Peinture moghole]. Collection privée.
Trouvée dans l’article : Hurel, R. (2022). The Disciple of the Yogini “Swallowed up” by the Tiger : Asceticism and Eremitic Life in Indian Painting. Journal Of The Royal Asiatic Society, 32(4), 982‑1002.